The cultivation of sugar cane is one of the best examples of what European agricultural colonization could do. It began in the 16th century in tropical countries, to supply the Old World with luxury products, where they were non-existent, such as tobacco, coffee, tea, cocoa, and sugar, rare in Europe three centuries ago in the form we know of it. Cane sugar, which in Antiquity was only an exotic curiosity, perhaps a medicine, was distributed by the Arabs in the Mediterranean world, particularly in Sicily and Spain from where Christopher Columbus brought it to Santo Domingo in 1515. It was to cultivate this “sweet reed” on a large scale that millions of Africans were deported into slavery in the New World.
The Arabs had discovered sugar cane and its many by-products in India, where its antiquity is attested by both botanists and linguists, since its cultivation is mentioned in the Atharvaveda (composed between 4000 and 1000 BC). J.C.). Moreover, the word “sugar”, after a long journey through Persian, Arabic, Greek and Latin, comes from a Sanskrit word çarkara, (sakkara in Pali) meaning “grains of sand”, given to raw cane sugar, reduced to a light brown powder.
Sugar cane is a perennial grass, with feathery panicles, with a very large culm, full of a more or less sweet marrow, erect, between 1 to 6m. height. This thatch is crushed or ground in an artisanal or industrial way to obtain a juice which, after various stages of cooking, will give syrup, sugar, and many derivative products including alcohols such as rum.
In Laos, sugar cane is grown in many gardens for family consumption and to be sold in markets, but it is not really processed. Peeled, cut into small sections, it is sold by street vendors as a chewy treat. The canes are also crushed by manual machines to extract the juice (nam oy) which will be drunk immediately because it turns quickly. If Laos and the countries of the Peninsula (with the exception of Vietnam) have not developed a sugar cane industry, it is because, traditionally, the sweet flavor is brought to food not by cane sugar. but by that of the sugar palm; here again the language confirms it: sugar is said in Lao nam tan, that is to say “water from the palm tree tan“.
However, the sweet taste, whatever its origin, is universally considered as “hot” and as such it has medicinal value, particularly in “colds”. More specifically, a variety of sugar cane, oy dam or oy deng, (black cane or red cane), is planted for its medicinal properties; it would be diuretic and used in the treatment of venereal diseases, in decoction, at the rate of 90 gr. for a liter of water, to drink during the day. Some healers, for their part, base their prescriptions on the number of knots in the cane: 7 or 9 depending on the patient’s sex are prescribed for yaws and gingivitis.
Finally, sugar cane is present in many rituals in Laos; cut into pieces, it accompanies betel, areca nut, bananas and cakes on the offering trays; in full stem, with or without its leaves, it is used in the construction of light and temporary buildings (ticket holders) during Buddhist ceremonies. Perhaps it thus contributes to satisfying the taste for sweetness manifested by supernatural beings.
La culture de la canne à sucre est l’un des meilleurs exemples de ce qu’a pu faire la colonisation agricole européenne. Elle commence dès le XVIème siècle dans les pays tropicaux, pour fournir l’Ancien Monde en produits de luxe, où ils étaient inexistants, tels le tabac, le café, le thé, le cacao, et le sucre, rare en Europe il y a trois siècles sous la forme que nous lui connaissons. Le sucre de canne qui n’était dans l’Antiquité qu’une curiosité exotique, à la rigueur un médicament, fut diffusé par les Arabes dans le monde méditerranéen, en particulier en Sicile et en Espagne d’où Christophe Colomb l’apporta à Saint Domingue en 1515. C’est pour cultiver ce « roseau sucré » sur une grande échelle que des millions d’Africains furent déportés en esclavage dans le Nouveau Monde.
Les Arabes, eux, avaient découverts la canne à sucre et ses nombreux produits dérivés, en Inde où son ancienneté est attestée, autant par les botanistes que par les linguistes, puisque sa culture est mentionnée dans l’Atharvaveda (composé entre 4000 et 1000 avant J.C.). Par ailleurs le mot « sucre », après un long cheminement qui passe par le persan, l’arabe, le grec et le latin, vient d’un mot sanscrit çarkara, (sakkara en pali) signifiant « grains de sable », nom donné au sucre de canne brut, réduit en une poudre brun clair.
La canne à sucre est une herbe pérenne, à panicules plumeuses, avec un chaume très gros, plein d’une moelle plus ou moins sucrée, érigé, entre 1 à 6m. de hauteur. Ce chaume est écrasé ou broyé de façon artisanale ou industrielle pour obtenir un jus qui, après différentes étapes de cuisson, donnera du sirop, du sucre, et de nombreux produits dérivés dont des alcools comme le rhum.
Au Laos la canne à sucre est cultivée dans beaucoup de jardin pour une consommation familiale et pour être vendue sur les marchés, mais elle ne fait pas l’objet d’une véritable transformation. Epluchée, découpée en petits tronçons elle est vendue par les marchands ambulants comme friandise à mâcher. Les cannes sont également broyées par des machines manuelles pour en extraire le jus (nam oy) qui sera bu immédiatement car il tourne vite. Si le Laos et les pays de la Péninsule (à l’exception du Viêtnam) n’ont pas développé une industrie de la canne à sucre c’est que, traditionnellement, la saveur sucrée est apportée aux aliments non pas par le sucre de canne mais par celui du palmier à sucre; là encore la langue le confirme: le sucre se dit en lao nam tan, c’est-à-dire « l’eau du palmier tan ».
Cependant la saveur sucrée, quelle que soit son origine, est universellement considérée comme « chaude » et à ce titre elle a valeur de médicament en particulier dans les « refroidissements ». Plus précisément, une variété de canne à sucre, oy dam ou oy deng, (canne noire ou canne rouge), est plantée pour ses vertus médicinales; elle serait diurétique et utilisée dans le traitement des maladies vénériennes, en décoction, à raison de 90gr. pour un litre d’eau, à boire dans la journée. Certains guérisseurs, quant à eux, basent leurs prescriptions sur le nombre de nœuds de la canne: 7 ou 9 selon le sexe des malades sont ordonnés contre le pian, la gingivite.
Enfin la canne à sucre est présente dans de nombreux rituels au Laos; coupée en morceaux elle accompagne le bétel, la noix d’arec, les bananes et les gâteaux sur les plateaux d’offrandes; en pleine tige, avec ou sans ses feuilles, elle entre dans la construction d’édifices légers et provisoires (porte-billets) lors des cérémonies bouddhistes. Peut-être contribue-t-elle ainsi à satisfaire le goût pour le sucré que manifestent les êtres surnaturels.





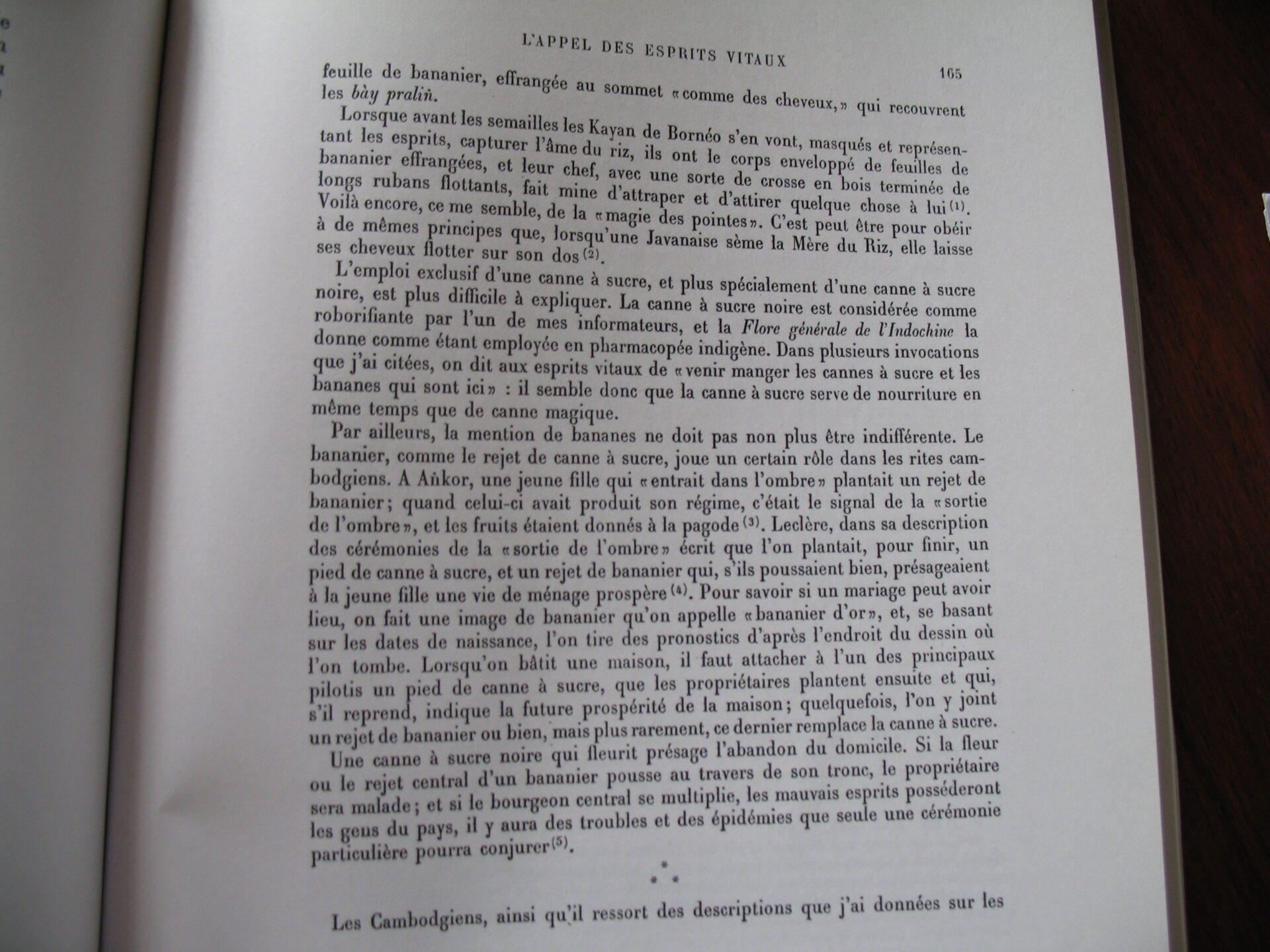
The cultivation of sugar cane is one of the best examples of what European agricultural colonization could do. It began in the 16th century in tropical countries, to supply the Old World with luxury products, where they were non-existent, such as tobacco, coffee, tea, cocoa, and sugar, rare in Europe three centuries ago in the form we know of it. Cane sugar, which in Antiquity was only an exotic curiosity, perhaps a medicine, was distributed by the Arabs in the Mediterranean world, particularly in Sicily and Spain from where Christopher Columbus brought it to Santo Domingo in 1515. It was to cultivate this “sweet reed” on a large scale that millions of Africans were deported into slavery in the New World.
The Arabs had discovered sugar cane and its many by-products in India, where its antiquity is attested by both botanists and linguists, since its cultivation is mentioned in the Atharvaveda (composed between 4000 and 1000 BC). J.C.). Moreover, the word “sugar”, after a long journey through Persian, Arabic, Greek and Latin, comes from a Sanskrit word çarkara, (sakkara in Pali) meaning “grains of sand”, given to raw cane sugar, reduced to a light brown powder.
Sugar cane is a perennial grass, with feathery panicles, with a very large culm, full of a more or less sweet marrow, erect, between 1 to 6m. height. This thatch is crushed or ground in an artisanal or industrial way to obtain a juice which, after various stages of cooking, will give syrup, sugar, and many derivative products including alcohols such as rum.
In Laos, sugar cane is grown in many gardens for family consumption and to be sold in markets, but it is not really processed. Peeled, cut into small sections, it is sold by street vendors as a chewy treat. The canes are also crushed by manual machines to extract the juice (nam oy) which will be drunk immediately because it turns quickly. If Laos and the countries of the Peninsula (with the exception of Vietnam) have not developed a sugar cane industry, it is because, traditionally, the sweet flavor is brought to food not by cane sugar. but by that of the sugar palm; here again the language confirms it: sugar is said in Lao nam tan, that is to say “water from the palm tree tan“.
However, the sweet taste, whatever its origin, is universally considered as “hot” and as such it has medicinal value, particularly in “colds”. More specifically, a variety of sugar cane, oy dam or oy deng, (black cane or red cane), is planted for its medicinal properties; it would be diuretic and used in the treatment of venereal diseases, in decoction, at the rate of 90 gr. for a liter of water, to drink during the day. Some healers, for their part, base their prescriptions on the number of knots in the cane: 7 or 9 depending on the patient’s sex are prescribed for yaws and gingivitis.
Finally, sugar cane is present in many rituals in Laos; cut into pieces, it accompanies betel, areca nut, bananas and cakes on the offering trays; in full stem, with or without its leaves, it is used in the construction of light and temporary buildings (ticket holders) during Buddhist ceremonies. Perhaps it thus contributes to satisfying the taste for sweetness manifested by supernatural beings.
La culture de la canne à sucre est l’un des meilleurs exemples de ce qu’a pu faire la colonisation agricole européenne. Elle commence dès le XVIème siècle dans les pays tropicaux, pour fournir l’Ancien Monde en produits de luxe, où ils étaient inexistants, tels le tabac, le café, le thé, le cacao, et le sucre, rare en Europe il y a trois siècles sous la forme que nous lui connaissons. Le sucre de canne qui n’était dans l’Antiquité qu’une curiosité exotique, à la rigueur un médicament, fut diffusé par les Arabes dans le monde méditerranéen, en particulier en Sicile et en Espagne d’où Christophe Colomb l’apporta à Saint Domingue en 1515. C’est pour cultiver ce « roseau sucré » sur une grande échelle que des millions d’Africains furent déportés en esclavage dans le Nouveau Monde.
Les Arabes, eux, avaient découverts la canne à sucre et ses nombreux produits dérivés, en Inde où son ancienneté est attestée, autant par les botanistes que par les linguistes, puisque sa culture est mentionnée dans l’Atharvaveda (composé entre 4000 et 1000 avant J.C.). Par ailleurs le mot « sucre », après un long cheminement qui passe par le persan, l’arabe, le grec et le latin, vient d’un mot sanscrit çarkara, (sakkara en pali) signifiant « grains de sable », nom donné au sucre de canne brut, réduit en une poudre brun clair.
La canne à sucre est une herbe pérenne, à panicules plumeuses, avec un chaume très gros, plein d’une moelle plus ou moins sucrée, érigé, entre 1 à 6m. de hauteur. Ce chaume est écrasé ou broyé de façon artisanale ou industrielle pour obtenir un jus qui, après différentes étapes de cuisson, donnera du sirop, du sucre, et de nombreux produits dérivés dont des alcools comme le rhum.
Au Laos la canne à sucre est cultivée dans beaucoup de jardin pour une consommation familiale et pour être vendue sur les marchés, mais elle ne fait pas l’objet d’une véritable transformation. Epluchée, découpée en petits tronçons elle est vendue par les marchands ambulants comme friandise à mâcher. Les cannes sont également broyées par des machines manuelles pour en extraire le jus (nam oy) qui sera bu immédiatement car il tourne vite. Si le Laos et les pays de la Péninsule (à l’exception du Viêtnam) n’ont pas développé une industrie de la canne à sucre c’est que, traditionnellement, la saveur sucrée est apportée aux aliments non pas par le sucre de canne mais par celui du palmier à sucre; là encore la langue le confirme: le sucre se dit en lao nam tan, c’est-à-dire « l’eau du palmier tan ».
Cependant la saveur sucrée, quelle que soit son origine, est universellement considérée comme « chaude » et à ce titre elle a valeur de médicament en particulier dans les « refroidissements ». Plus précisément, une variété de canne à sucre, oy dam ou oy deng, (canne noire ou canne rouge), est plantée pour ses vertus médicinales; elle serait diurétique et utilisée dans le traitement des maladies vénériennes, en décoction, à raison de 90gr. pour un litre d’eau, à boire dans la journée. Certains guérisseurs, quant à eux, basent leurs prescriptions sur le nombre de nœuds de la canne: 7 ou 9 selon le sexe des malades sont ordonnés contre le pian, la gingivite.
Enfin la canne à sucre est présente dans de nombreux rituels au Laos; coupée en morceaux elle accompagne le bétel, la noix d’arec, les bananes et les gâteaux sur les plateaux d’offrandes; en pleine tige, avec ou sans ses feuilles, elle entre dans la construction d’édifices légers et provisoires (porte-billets) lors des cérémonies bouddhistes. Peut-être contribue-t-elle ainsi à satisfaire le goût pour le sucré que manifestent les êtres surnaturels.





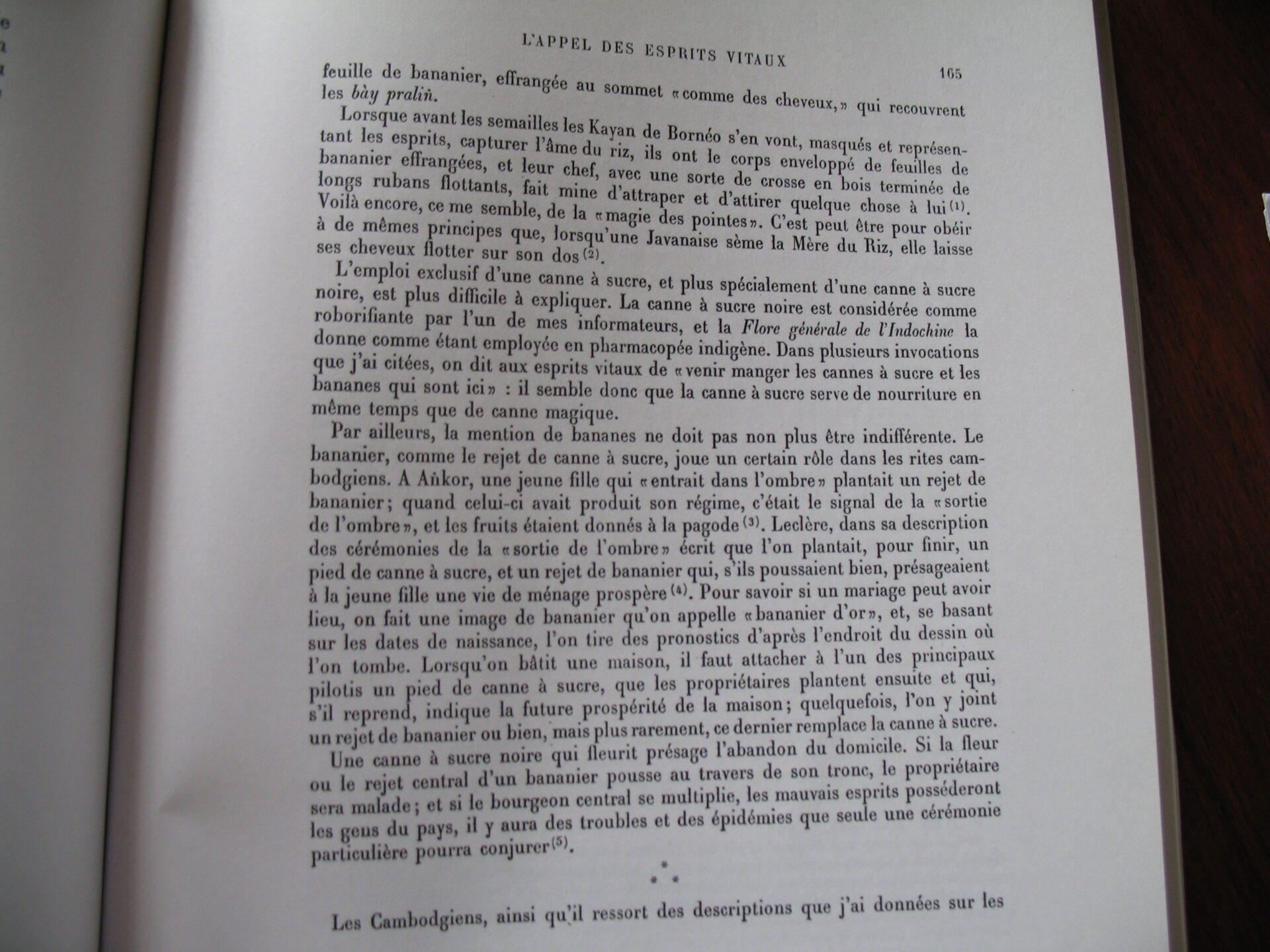





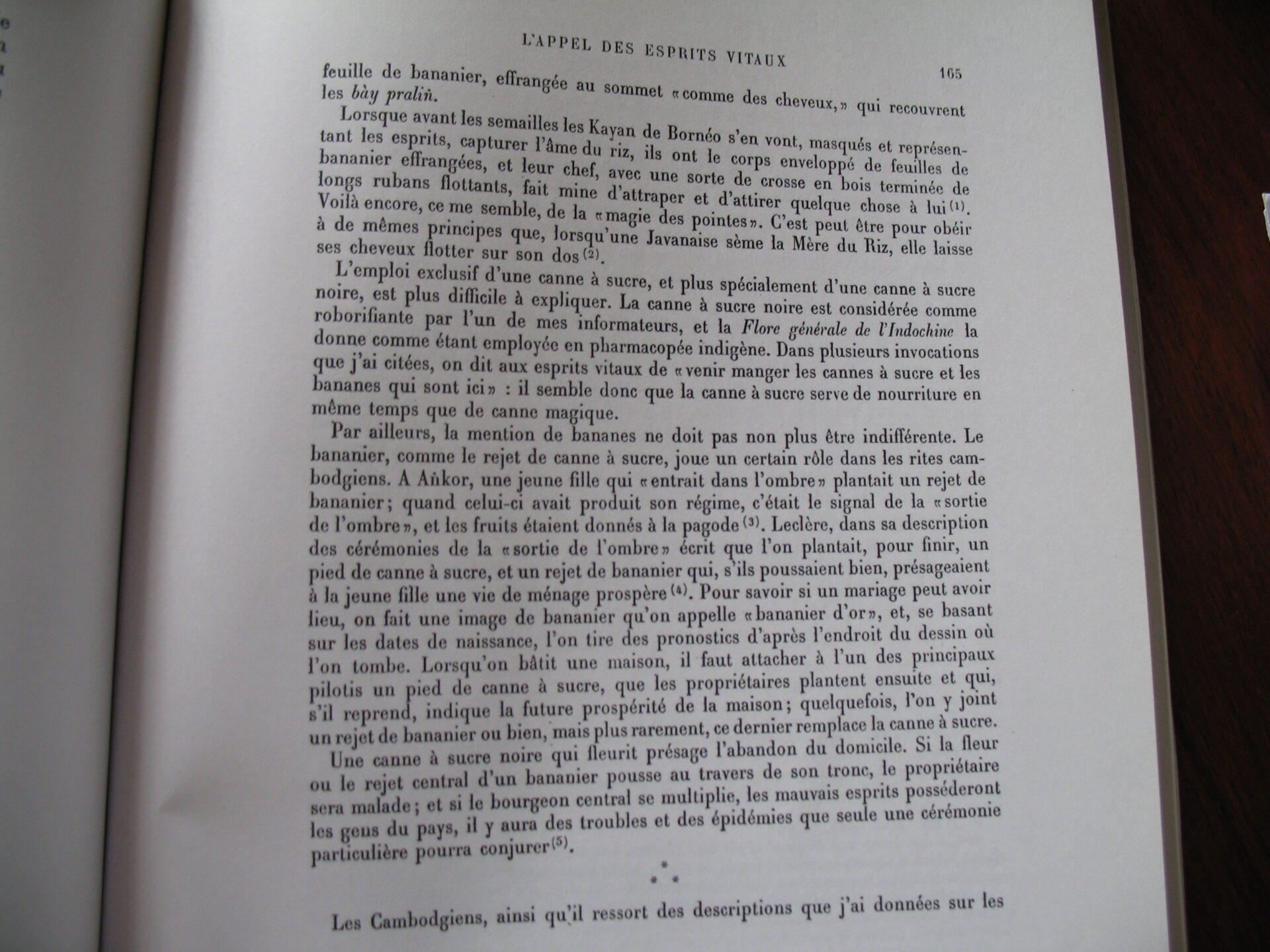
The cultivation of sugar cane is one of the best examples of what European agricultural colonization could do. It began in the 16th century in tropical countries, to supply the Old World with luxury products, where they were non-existent, such as tobacco, coffee, tea, cocoa, and sugar, rare in Europe three centuries ago in the form we know of it. Cane sugar, which in Antiquity was only an exotic curiosity, perhaps a medicine, was distributed by the Arabs in the Mediterranean world, particularly in Sicily and Spain from where Christopher Columbus brought it to Santo Domingo in 1515. It was to cultivate this “sweet reed” on a large scale that millions of Africans were deported into slavery in the New World.
The Arabs had discovered sugar cane and its many by-products in India, where its antiquity is attested by both botanists and linguists, since its cultivation is mentioned in the Atharvaveda (composed between 4000 and 1000 BC). J.C.). Moreover, the word “sugar”, after a long journey through Persian, Arabic, Greek and Latin, comes from a Sanskrit word çarkara, (sakkara in Pali) meaning “grains of sand”, given to raw cane sugar, reduced to a light brown powder.
Sugar cane is a perennial grass, with feathery panicles, with a very large culm, full of a more or less sweet marrow, erect, between 1 to 6m. height. This thatch is crushed or ground in an artisanal or industrial way to obtain a juice which, after various stages of cooking, will give syrup, sugar, and many derivative products including alcohols such as rum.
In Laos, sugar cane is grown in many gardens for family consumption and to be sold in markets, but it is not really processed. Peeled, cut into small sections, it is sold by street vendors as a chewy treat. The canes are also crushed by manual machines to extract the juice (nam oy) which will be drunk immediately because it turns quickly. If Laos and the countries of the Peninsula (with the exception of Vietnam) have not developed a sugar cane industry, it is because, traditionally, the sweet flavor is brought to food not by cane sugar. but by that of the sugar palm; here again the language confirms it: sugar is said in Lao nam tan, that is to say “water from the palm tree tan“.
However, the sweet taste, whatever its origin, is universally considered as “hot” and as such it has medicinal value, particularly in “colds”. More specifically, a variety of sugar cane, oy dam or oy deng, (black cane or red cane), is planted for its medicinal properties; it would be diuretic and used in the treatment of venereal diseases, in decoction, at the rate of 90 gr. for a liter of water, to drink during the day. Some healers, for their part, base their prescriptions on the number of knots in the cane: 7 or 9 depending on the patient’s sex are prescribed for yaws and gingivitis.
Finally, sugar cane is present in many rituals in Laos; cut into pieces, it accompanies betel, areca nut, bananas and cakes on the offering trays; in full stem, with or without its leaves, it is used in the construction of light and temporary buildings (ticket holders) during Buddhist ceremonies. Perhaps it thus contributes to satisfying the taste for sweetness manifested by supernatural beings.
La culture de la canne à sucre est l’un des meilleurs exemples de ce qu’a pu faire la colonisation agricole européenne. Elle commence dès le XVIème siècle dans les pays tropicaux, pour fournir l’Ancien Monde en produits de luxe, où ils étaient inexistants, tels le tabac, le café, le thé, le cacao, et le sucre, rare en Europe il y a trois siècles sous la forme que nous lui connaissons. Le sucre de canne qui n’était dans l’Antiquité qu’une curiosité exotique, à la rigueur un médicament, fut diffusé par les Arabes dans le monde méditerranéen, en particulier en Sicile et en Espagne d’où Christophe Colomb l’apporta à Saint Domingue en 1515. C’est pour cultiver ce « roseau sucré » sur une grande échelle que des millions d’Africains furent déportés en esclavage dans le Nouveau Monde.
Les Arabes, eux, avaient découverts la canne à sucre et ses nombreux produits dérivés, en Inde où son ancienneté est attestée, autant par les botanistes que par les linguistes, puisque sa culture est mentionnée dans l’Atharvaveda (composé entre 4000 et 1000 avant J.C.). Par ailleurs le mot « sucre », après un long cheminement qui passe par le persan, l’arabe, le grec et le latin, vient d’un mot sanscrit çarkara, (sakkara en pali) signifiant « grains de sable », nom donné au sucre de canne brut, réduit en une poudre brun clair.
La canne à sucre est une herbe pérenne, à panicules plumeuses, avec un chaume très gros, plein d’une moelle plus ou moins sucrée, érigé, entre 1 à 6m. de hauteur. Ce chaume est écrasé ou broyé de façon artisanale ou industrielle pour obtenir un jus qui, après différentes étapes de cuisson, donnera du sirop, du sucre, et de nombreux produits dérivés dont des alcools comme le rhum.
Au Laos la canne à sucre est cultivée dans beaucoup de jardin pour une consommation familiale et pour être vendue sur les marchés, mais elle ne fait pas l’objet d’une véritable transformation. Epluchée, découpée en petits tronçons elle est vendue par les marchands ambulants comme friandise à mâcher. Les cannes sont également broyées par des machines manuelles pour en extraire le jus (nam oy) qui sera bu immédiatement car il tourne vite. Si le Laos et les pays de la Péninsule (à l’exception du Viêtnam) n’ont pas développé une industrie de la canne à sucre c’est que, traditionnellement, la saveur sucrée est apportée aux aliments non pas par le sucre de canne mais par celui du palmier à sucre; là encore la langue le confirme: le sucre se dit en lao nam tan, c’est-à-dire « l’eau du palmier tan ».
Cependant la saveur sucrée, quelle que soit son origine, est universellement considérée comme « chaude » et à ce titre elle a valeur de médicament en particulier dans les « refroidissements ». Plus précisément, une variété de canne à sucre, oy dam ou oy deng, (canne noire ou canne rouge), est plantée pour ses vertus médicinales; elle serait diurétique et utilisée dans le traitement des maladies vénériennes, en décoction, à raison de 90gr. pour un litre d’eau, à boire dans la journée. Certains guérisseurs, quant à eux, basent leurs prescriptions sur le nombre de nœuds de la canne: 7 ou 9 selon le sexe des malades sont ordonnés contre le pian, la gingivite.
Enfin la canne à sucre est présente dans de nombreux rituels au Laos; coupée en morceaux elle accompagne le bétel, la noix d’arec, les bananes et les gâteaux sur les plateaux d’offrandes; en pleine tige, avec ou sans ses feuilles, elle entre dans la construction d’édifices légers et provisoires (porte-billets) lors des cérémonies bouddhistes. Peut-être contribue-t-elle ainsi à satisfaire le goût pour le sucré que manifestent les êtres surnaturels.


